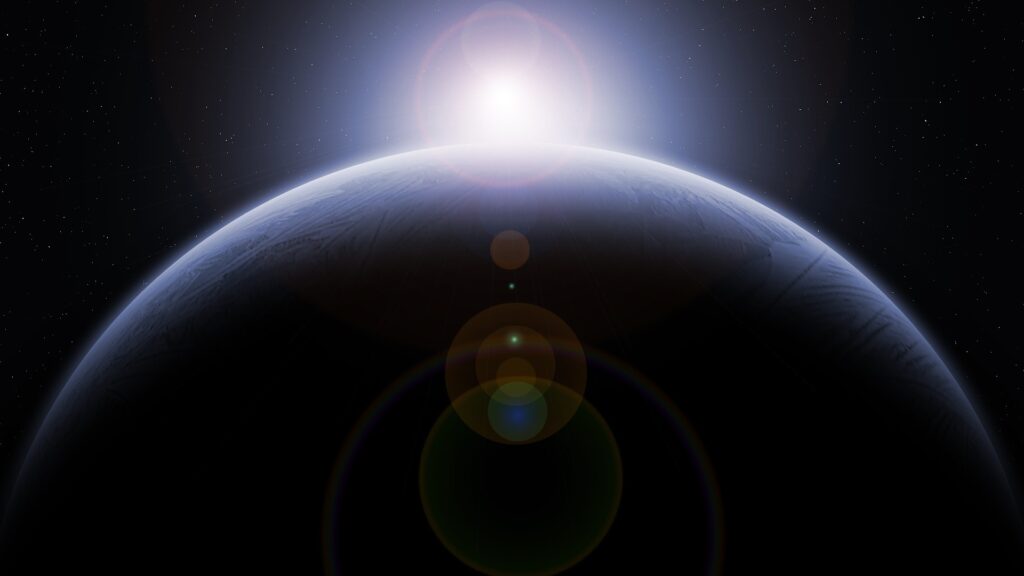L’astrobiologie : définition, historique et méthodes de recherches
Image libre de droit / Pixabay Quelle est l’origine de la Vie ? Pourquoi est-elle apparue sur Terre ? Les hommes sont-ils les seuls êtres vivants dans l’espace ?.. Honnêtement à un moment ou un autre, je crois qu’on s’est déjà tous posé ces questions. Mais même si des recherches ont toujours été menées pour trouver des réponses, il faudra attendre les années 50 pour que les premières explications scientifiques convaincantes émergent. Le premier résultat significatif fut alors l’expérience de Miller : « L’expérience de Miller Urey a montré en 1952 qu’il était possible de fabriquer des molécules organiques nécessaires à la vie, à partir de l’énergie des éclairs et de simples gaz présents dans l’atmosphère de la Terre il y a quatre milliards d’années »1. Quelques années plus tard, dans le cadre du premier programme Apollo développé par la NASA, Joshua Lederberg, prix Nobel de médecine en 1958 et fondateur de la biologie moléculaire, posa les bases d’une nouvelle science, l’exobiologie, chargée d’étudier la vie sur terre et les possibilités de son existence sur d’autres planètes. Par définition, « L’exobiologie (ou astrobiologie) est une science interdisciplinaire qui a pour objet l’étude des facteurs et processus, notamment géochimiques et biochimiques, pouvant mener à l’apparition de la vie, d’une manière générale, et à son évolution »2. Comme on peut s’y attendre, les résultats en astrobiologie reposent énormément sur les données fournies par les sondes lors de l’exploration spatiale, mais pas que. En effet, « Cette recherche peut se faire dans le système solaire par télédétection ou, depuis peu, grâce au développement des technologies spatiales, par mesures in situ. Elle peut aussi se faire hors du système solaire, par l’approche SETI et devrait pouvoir se faire dans un futur proche, par la détermination de la composition des atmosphères des planètes extrasolaires »3. Aujourd’hui, après des années de recherches, les astrobiologistes sont en mesure de nous fournir des réponses quoique parfois partielles sur la vie dans l’univers, réponses que nous allons d’ailleurs présenter dans la suite de notre blog. 1 : Québec science ; Quand la science se penche sur les origines de la vie (2021) 2 : Société Française d’Exobiologie, Qu’est-ce que l’exobiologie ? 3 : François Raulin (2008), La revue pour l’histoire du CNRS, De l’exobiologie à l’astrobiologie